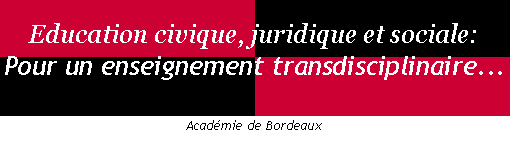Problématique
De toutes parts, il est fait appel au droit: pour justifier l’expulsion d’un étranger mais aussi pour la contester, pour favoriser l’égal accès des femmes aux fonctions et mandats et aussi pour permettre les unions entre personnes de même sexe, pour imposer une réduction de la durée du travail et aussi pour combattre l’exclusion, pour fixer un cadre aux activités du réseau Internet et aussi pour organiser la chasse ... Pourquoi cet " appel " ? Parce que, là où il y a de la société, il y a des conflits et des contradictions et, par conséquent, besoin et demande de règles pour les "traiter ". Le droit, c’est, d’abord, l’ensemble des règles par lesquelles s’expriment les contradictions d’une société et, en même temps, qui se présentent comme le moyen de gérer à un moment donné les conflits auxquels elle donnent lieu.
Cette interprétation du droit donne lieu, habituellement, à deux lectures. Pour les uns, le droit masque, par un vocabulaire apparemment neutre et objectif, une domination sociale et, en particulier, une domination des forces de l’argent. Pour les autres au contraire, le droit libère l’homme des oppressions que la nature, le marché et les habitudes, laissés libres d’agir, font peser sur lui. Sans doute, chacun énonce-t-il une part de vérité. Mais les premiers oublient que bon nombre de règles juridiques ont été imposées aux dominants par les luttes sociales et les seconds que la force de la loi peut aussi être injuste.
Il est aussi possible de suggérer que le droit, dans son domaine propre, exprime la capacité des hommes à se représenter, individuellement et collectivement, et à organiser leurs relations. Cette compréhension implique que le droit inaugure une forme sociale où les hommes ne sont pas en " fusion" avec une instance extérieure pesant et pensant pour eux - la communauté, la nature, l’Etat, ... - mais en relation pour construire leurs règles.
Le droit permet d’abord de respecter la dignité de chaque individu et de le mettre en relation avec les autres pour élaborer les règles communes. Il constitue ensuite une pratique organisée des discussions et des délibérations par lesquelles ces règles sont élaborées. Enfin, il a aussi une fonction instituante. Il ne traduit pas seulement les valeurs collectives, il contribue à les former. Il existe une relation continue entre ceux qui ont écrit les règles de droit et ceux qui les appliquent.
Démarche
1 - Montrer, par des exemples pris dans l’actualité, comment se construit le lien entre "demande sociale" et "demande de droit" mouvement des exclus / loi sur l’exclusion; mouvement des chasseurs / loi sur la chasse; mouvement des lycéens! loi sur la citoyenneté lycéenne ....
2 - Afin de montrer que le droit s’oppose au mode fusionnel de "traitement" des contradictions, prendre un exemple - la chasse, la vitesse routière, la drogue, ... - qui fasse apparaître la spécificité du mode relationnel impliqué par le droit: échange des arguments des parties en désaccord (chasseurs / écologistes) supposant la reconnaissance et la représentation des contradictions; espaces de discussion et d’élaboration de la future règle ( la rue, les tribunaux, le Parlement, les associations, la Commission de Bruxelles, ...).
3 - Le sens du droit ne se trouve pas enserré dans la lettre de la règle; montrer la difficulté à connaître la volonté "exacte" des "écrivains de la règle" ( que veut dire le législateur quand il écrit "menace grave pour l’ordre public ": héberger un étranger en situation irrégulière? brûler un feu rouge ~‘ ) et le rôle des agents sociaux dans la détermination du sens d’une règle.