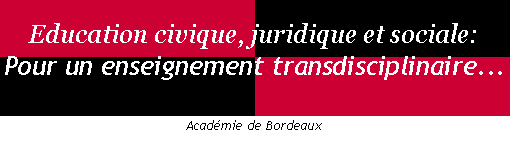Problématique
Droits individuels / droits collectifs, a priori, la distinction s’impose
"naturellement": les premiers n’ont besoin de personne d’autre
que l’individu pour s’exercer et s’accomplissent pleinement dans et par
un usage solitaire alors que les seconds ne prennent sens que par une action
conjointe de plusieurs individus et se réalisent seulement par un exercice en
commun; les premiers sont des droits-libertés qui protègent l’autonomie
des personnes, leur donnent des capacités d’action et impliquent en conséquence
l’abstention de l’Etat, alors que les seconds sont des droits-créances
qui expriment une revendication sociale, exigent des moyens et impliquent en
conséquence une intervention de l’Etat.
L’opposition est claire et a le mérite de recouper, globalement,
l’opposition généralement admise entre la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la constitution de 1946.
D’un côté, la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience, la
liberté de disposer de soi, la philosophie libérale et l’idée d’un Etat
minimum, de l’autre, la liberté syndicale, le droit au travail, le droit de
grève, le droit à l’éducation, la philosophie socialiste et 1’
Etat-Providence.
D’où la question classique: droits-libertés et droits-créances sont-ils
conciliables? Plusieurs réponses ont été proposées, celle de leur
impossible conciliation comme celle de leur possible concorde, celle de la
soumission des droits-créances à la logique des droits-libertés comme celle
de la subordination des droits-libertés aux droits-créances. Quelle que soit
leur différence, ces réponses se fondent sur le même postulat:
l’opposition de nature entre les droits-libertés et les droits-créances.
Or, il est aussi possible de considérer que ces deux catégories de droits
ont la même nature, celle d’ouvrir un espace de communication / entre les
hommes, celle d’être également des droits relationnels.
Démarche
1-Prendre la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946 pour en faire une
étude historique (conditions d’élaboration) et philosophique ( droits préexistant
à l’Etat ou droits donnés par l’Etat).
2 - A partir des libertés énoncées en 1789 et 1946, donner
des exemples illustrant clairement chacune d’entre elles et tenter de les
faire entrer, soit dans la catégorie "droits individuels ", soit
dans la catégorie "droits collectifs ". Provoquer une discussion
sur les désaccords éventuels du classement.
3 - A partir d’un problème concret, faire travailler les élèves
sur les différentes possibilités de conciliation de droits concurrents. Par
exemple, au nom du droit à la protection de la santé publique — droit-créance
— l’Etat peut-il intervenir pour limiter ou interdire la possibilité de
fumer, ou, au nom de la liberté individuelle — droit-liberté — doit-il
s’abstenir de poser toute réglementation en la matière?