
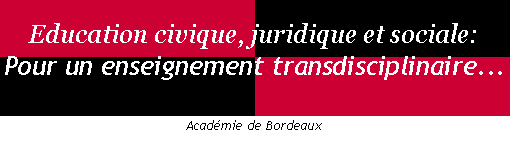
|
|
|
Fiche 6: Diversité des traditions culturelles et culture commune (classe de seconde)
1. Une première étape pourrait montrer le sens de
l’abstention de l’Etat dans les affaires religieuses. Rappeler que l’idée
est née à la suite des guerres de religion au XVIIème siècle, elle est
apparue alors comme le moyen de faire vivre catholiques et protestants dans la même
société politique. C’est donc un principe fondateur de la culture commune.
En montrant que ce n’est pas seulement un problème français, mais un
principe général de la citoyenneté, on pourrait aussi montrer les formes
particulières qu’il a prises en France, sous le terme de laïcité. On
pourrait aussi souligner, par la comparaison avec d’autres pays démocratiques,
que le principe de la neutralité religieuse de l’Etat, fondateur de l’ordre
démocratique, peut continuer à évoluer dans ses formes concrètes, étant
donné les transformations des sociétés contemporaines. 2 - On pourrait amener les élèves, dans une deuxième étape,
à réfléchir sur les limites de la diversité admise et admissible. Peut-on
accepter toutes les pratiques, en particulier celles qui sont incompatibles avec
les droits de l’homme, par exemple l’excision des petites filles, ou l’inégalité
des droits des hommes et des femmes? Ce serait l’occasion de montrer que la
culture commune assurée par la citoyenneté repose sur des valeurs communes,
celles qui assurent l’égale dignité de tous les hommes. 3- On pourrait, dans une troisième étape, soulever le problème des instruments de la citoyenneté. Cette dernière n’implique-t-elle pas que tous les citoyens partagent une langue et un langage communs, qui permettent de gérer les rivalités et les conflits selon les règles de droit ? La liberté de pratiquer une langue particulière dans le privé, chez soi ou avec ses amis, peut-elle déboucher automatiquement sur sa reconnaissance dans l’espace public, dans l’hôpital, dans l’administration, dans les institutions politiques ? Comment, concrètement concilier, la liberté culturelle de chacun et les exigences de la vie collective 7 Jusqu’où peut-on accepter la diversité dans l’espace public, qui est l’espace de la citoyenneté et de la culture communes?
|
|