![]()
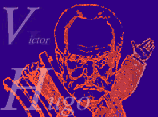
| Bordeaux | Les Landes | Bayonne et Biarritz |
| 1. Prenez
Versailles et mêlez-y Anvers 2. Le vieux Bordeaux 3. La Gironde et les Bordelaises 4. Bordeaux ville d'histoire 5. Le Bordeaux disparu 6. Le pont de Bordeaux 7. La cathédrale Saint-André 8. Plaidoyer pour la sauvegarde du patrimoine de Bordeaux 9. Les momies de Saint-Michel 10. La tour Saint-Michel |
11. Les
Landes ; les pins 12. Au-delà de Roquefort 13. Les sables des Landes 14. De Roquefort à Tartas 15. Les lièvres de Tartas 16. Le pont de Dax |
17. Une
maison sur le port de Bayonne
18. Une vue générale de Bayonne 19. La cathédrale de Bayonne 20. Vue de Biarritz 21. Les baigneuses de Biarritz 22. Une vision prophétique de Biarritz 23. De Bayonne à Biarritz, les aléas d'un touriste 24. Le château de Marrac, un épisode historique |

