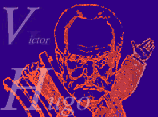|
Du reste l'omnibus de Bayonne à Biarritz ne s'établit
pas sans résistance. Le coucou se débat contre l'omnibus,
comme sans doute il y a dix ans le cacolet a lutté contre
le coucou. Tous les voituriers de la ville se révoltent contre
deux selliers, Castex et Anatol, qui ont imaginé les omnibus.
Il y a ligue, concurrence, coalition. C'est une iliade de cochers
de fiacre qui expose la bourse du voyageur à des soubresauts
bizarres. Le lendemain de mon arrivée à Bayonne, je
voulus aller à Biarritz. Ne sachant pas le chemin, je m'adressai
à un passant, paysan navarrais qui avait un beau costume,
un large pantalon de velours olive, une ceinture rouge, une chemise
à grand col rabattu rattachée d'un anneau d'argent,
une veste de gros drap chocolat toute brodée de soie brune,
et un petit chapeau à la Henri II bordé de velours
et rehaussé d'une plume d'autruche noire et frisée.
Je demandai à ce magnifique passant le chemin de Biarritz.
- Prenez la rue du Pont Mayour, me dit-il, et suivez-la jusqu'à
la porte d'Espagne. - Est-il aisé, ajoutai-je, de trouver
des voitures pour aller à Biarritz ? - Le navarrais me regarda
souriant d'un sourire grave et me dit, avec l'accent de son pays,
cette parole mémorable dont je ne compris que plus tard toute
la profondeur : - Monsieur, il est facile d'y aller, mais difficile
d'en revenir. - Je pris la rue du Pont Mayour ; tout en la montant
je rencontrai plusieurs affiches de couleurs variées par
lesquelles des voituriers offraient des voitures au public pour
Biarritz et à divers prix honnêtes ; je remarquai,
mais fort négligemment, que toutes ces affiches se terminaient
par l'invariable protocole que voici : - les prix resteront ainsi
fixés jusqu'à huit heures du soir.
J'arrivai
à la porte d'Espagne. Là, se groupaient et s'entassaient
pêle-mêle une foule de voitures de toutes sortes, chars
à bancs cabriolets, coucous, gondoles, calèches, coupés,
omnibus. J'avais à peine jeté un coup d'œil sur
cette cohue d'attelages qu'une autre cohue m'entourait déjà.
C'était les cochers. En un moment je fus assourdi. Toutes
les voix, tous les accents, tous les patois, tous les jurons et
toutes les offres à la fois. L'un me prit le bras droit.
- Monsieur, je suis le cocher de monsieur Castex. Montez dans le
coupé. Une place pour quinze sous. L'autre me prit le bras
gauche : - Monsieur, je suis Ruspil, j'ai aussi un coupé
: une place pour douze sous. Un troisième me barra le chemin
: - Monsieur, c'est moi Anatol, voilà ma calèche ;
je vous mène pour dix sous. Un quatrième me parlait
dans les oreilles : - Monsieur, venez avec Momus. Je suis Momus.
Ventre à terre à Biarritz pour six sous. Cinq sous,
criaient d'autres têtes autour de moi ! Voyez, monsieur, la
jolie voiture. La Sultane de Biarritz ! Une place pour cinq
sous ! - Le premier qui m'avait parlé et qui me tenait le
bras droit domina enfin tout le vacarme : - Monsieur, c'est moi
qui vous ai parlé le premier. Je vous demande la préférence.
- Il vous demande quinze sous, crièrent les autres cochers.
- Monsieur, reprit l'homme froidement, je vous demande trois sous.
Il se fit un grand silence. - J'ai parlé à monsieur
le premier, ajouta l'homme. Puis, profitant de la stupeur des autres
combattants, il ouvrit vivement la portière de son coupé,
m'y poussa avant que j'eusse le temps de me reconnaître, referma
le coupé, monta sur son siège, et partit au galop.
Son omnibus était plein. Il semblait qu'il n'attendit que
moi.
La
voiture était toute neuve et fort bonne, les chevaux excellents.
En moins d'une demi-heure, nous étions à Biarritz.
Arrivé là, ne voulant pas abuser de ma position, je
tirai quinze sous de ma bourse et je les donnai au cocher. J'allais
m'éloigner. Il me retint par le bras. - Monsieur, me dit-il,
ce n'est que trois sous. - Bah ! Repris-je. Vous m'avez dit quinze
sous d'abord. Ce sera quinze sous. - Non pas, monsieur, j'ai dit
que je vous mènerais pour trois sous. C'est trois sous. Il
me rendit le surplus et me força presque de le recevoir.
- Pardieu, disais-je en m'en allant, voilà un honnête
homme.
Les
autres voyageurs n'avaient comme moi, donné que trois sous.
Après
m'être promené tout le jour sur la plage, le soir venu,
je songeai à regagner Bayonne. J'étais las, et je
ne pensais pas sans quelque plaisir à l'excellente voiture
et au vertueux cocher qui m'avaient amené. Huit heures sonnaient
aux lointaines horloges de la plaine comme je remontais l'escarpement
du port-vieux. Je ne pris pas garde à une foule de promeneurs
qui accouraient de tous les points et semblaient se hâter
vers l'entrée du village où s'arrêtent les voituriers.
La soirée était superbe ; quelques étoiles
commençaient à piquer le ciel clair au crépuscule
; la mer à peine émue avait le miroitement opaque
et lourd d'une immense nappe d'huile; un phare à feu tournant
venait de s'allumer à ma droite sur un cap voisin ; il brillait,
puis s'éteignait, puis se ravivait tout à coup et
jetait brusquement une éclatante lumière comme s'il
cherchait à lutter avec l'éternel Sirius qui resplendissait
dans la brume à l'autre bout de l'horizon. Je m'arrêtai,
et je considérai quelque temps ce mélancolique spectacle,
qui était pour moi comme la figure de l'effort humain en
présence du pouvoir divin. Cependant la nuit s'épaississait,
et à un certain moment l'idée de Bayonne et de mon
auberge traversa subitement ma contemplation. Je me remis en marche
et j'atteignis la place des voitures. Il n'y en avait plus qu'une
seule ; un falot posé à terre me le montra ; c'était
une calèche à quatre places ; trois places étaient
déjà occupées. Comme j'approchais :
- Hé, monsieur, venez donc, me cria une voix, c'est la dernière
place, et nous sommes la dernière voiture. Je reconnus la
voix de mon cocher du matin. Je retrouvais cet homme antique. Le
hasard me parut providentiel. Je louai Dieu. Un moment plus tard,
j'étais forcé de faire la route à pied, une
bonne lieue de pays. Pardieu, lui dis-je, vous êtes un brave
cocher, et je suis aise de vous revoir. Montez vite, monsieur, reprit
l'homme. Je m'installai en hâte dans la calèche. Quand
je fus assis, le cocher, la main sur la clef de la portière,
me dit: - Monsieur sait que l'heure est passée ? - Quelle
heure ? lui dis-je. - Huit heures. - C'est vrai. J'ai entendu sonner
quelque chose comme cela. - Monsieur sait, repartit l'homme, que
passé huit heures du soir le prix change. Nous venons chercher
ici les voyageurs pour les obliger. L'usage est de payer avant de
partir. - A merveille, répondis-je en tirant ma bourse. Combien
est-ce ? L'homme reprit avec douceur : - Monsieur, c'est douze francs.
-
Je compris sur le champ l'opération. Le matin on annonce
qu'on mènera les curieux à Biarritz pour trois sous
par personne : il y a foule; le soir, on ramène cette foule
à Bayonne pour douze francs par tête. J'avais éprouvé
le matin même la rigidité stoïque de mon cocher,
je ne répliquai pas un mot, et je payai.
Tout en regagnant Bayonne au galop, la belle maxime du paysan navarrais
me revint à 'esprit, et j'en fis, pour l'enseignement des
voyageurs, cette traduction en langue vulgaire : VOITURES POUR BIARRITZ.
Prix, par personne, pour aller : trois sous ; pour revenir:
Douze francs. Ne trouvez-vous pas que c'est là une
belle oscillation ?

|
![]()