|
De Roquefort à Tartas, les pins font place à une foule
d'autres arbres. Une végétation variée et puissante
s'empare des plaines et des collines, et la route court à
travers un jardin ravissant. On passe à chaque instant sur
de vieux ponts à arches ogives de charmantes rivières,
d'abord la Douze, puis le Midou, puis la Midouze, formée
comme le nom l'indique de la Douze et du Midou, puis l'Adour. La
syllabe dour ou dou qui se retrouve dans tous ces noms vient évidemment
du mot celte tur qui signifie cours d'eau. Toutes ces rivières
sont profondément encaissées limpides, vertes, gaies.
Les jeunes filles battent le linge au bord de l'eau, les chardonnerets
chantent dans les buissons, une vie heureuse respire dans cette
douce nature. Cependant, par moments, entre deux branches d'arbres
que le vent écarte joyeusement, on aperçoit au loin
à l'horizon les bruyères et les piñadas voilées
par les rougeurs du couchant, et l'on se souvient qu'on est dans
les Landes. On songe qu'au delà de ce riant jardin, semé
de toutes ces jolies villes, Roquefort, Mont-de-Marsan, Tartas,
coupé de toutes ces fraîches rivières, l'Adour,
la Douze, le Midou, à quelques heures de marche, est la forêt,
puis au delà de la forêt, la bruyère, la lande,
le désert, sombre solitude où la cigale chante, où
l'oiseau se tait, où toute habitation humaine disparaît,
et que traversent silencieusement à de longs intervalles
des caravanes de grands bœufs vêtus de linceuls blancs,
on se dit qu'au delà de ces solitudes de sable sont  les
étangs, solitudes d'eau, Sanguinet, Parentis, Mimizan, Léon,
Biscarosse, avec leur fauve population de loups, de putois, de sangliers
et d'écureuils, avec leur végétation inextricable,
surier, laurier franc, robinier, cyste à feuilles de sauge,
houx énormes, aubépines gigantesques, ajoncs de vingt
pieds de haut, avec leurs forêts vierges où l'on ne
peut s'aventurer sans une hache et une boussole ; on se représente
au milieu de ces bois immenses le grand Cassou, ce chêne mystérieux
dont le branchage hideux secoue sur toute la contrée les
superstitions et les terreurs. On pense qu'au delà des étangs
il y a les dunes, montagnes de sable qui marchent, qui chassent
les étangs devant elles, qui engloutissent les piñadas,
les villages, et les clochers, et dont les ouragans changent la
forme ; et l'on se dit qu'au delà des dunes il y a l'océan.
Les dunes dévorent les étangs ; l'océan dévore
les dunes. Ainsi, les landes, les étangs, les dunes, la mer,
voilà les quatre zones que la pensée traverse. On
se les figure l'une après l'autre, toutes plus farouches
les unes que les autres. On voit les vautours voler au dessus des
landes, les grues au dessus des lagunes, et les goëlands au
dessus de la mer. On regarde ramper sur les dunes les tortues et
les serpents. Le spectre d'une nature morne vous apparaît.
La rêverie emplit l'esprit. Des paysages inconnus et fantastiques
tremblent et miroitent devant vos yeux. Des hommes appuyés
sur un long bâton et montés sur des échasses
passent dans les brumes de l'horizon sur la crête des collines
comme de grandes araignées ; on croit voir se dresser dans
les ondulations des dunes les pyramides énigmatiques de Mimizan,
et l'on prête l'oreille comme si l'on entendait le chant sauvage
et doux des paysannes de Parentis, et l'on regarde au loin comme
si l'on voyait marcher pieds nus dans les vagues les belles filles
de Biscarosse coiffées d'immortelles de mer. les
étangs, solitudes d'eau, Sanguinet, Parentis, Mimizan, Léon,
Biscarosse, avec leur fauve population de loups, de putois, de sangliers
et d'écureuils, avec leur végétation inextricable,
surier, laurier franc, robinier, cyste à feuilles de sauge,
houx énormes, aubépines gigantesques, ajoncs de vingt
pieds de haut, avec leurs forêts vierges où l'on ne
peut s'aventurer sans une hache et une boussole ; on se représente
au milieu de ces bois immenses le grand Cassou, ce chêne mystérieux
dont le branchage hideux secoue sur toute la contrée les
superstitions et les terreurs. On pense qu'au delà des étangs
il y a les dunes, montagnes de sable qui marchent, qui chassent
les étangs devant elles, qui engloutissent les piñadas,
les villages, et les clochers, et dont les ouragans changent la
forme ; et l'on se dit qu'au delà des dunes il y a l'océan.
Les dunes dévorent les étangs ; l'océan dévore
les dunes. Ainsi, les landes, les étangs, les dunes, la mer,
voilà les quatre zones que la pensée traverse. On
se les figure l'une après l'autre, toutes plus farouches
les unes que les autres. On voit les vautours voler au dessus des
landes, les grues au dessus des lagunes, et les goëlands au
dessus de la mer. On regarde ramper sur les dunes les tortues et
les serpents. Le spectre d'une nature morne vous apparaît.
La rêverie emplit l'esprit. Des paysages inconnus et fantastiques
tremblent et miroitent devant vos yeux. Des hommes appuyés
sur un long bâton et montés sur des échasses
passent dans les brumes de l'horizon sur la crête des collines
comme de grandes araignées ; on croit voir se dresser dans
les ondulations des dunes les pyramides énigmatiques de Mimizan,
et l'on prête l'oreille comme si l'on entendait le chant sauvage
et doux des paysannes de Parentis, et l'on regarde au loin comme
si l'on voyait marcher pieds nus dans les vagues les belles filles
de Biscarosse coiffées d'immortelles de mer.
Car la pensée a ses mirages. Les voyages que la diligence-Dotézac
ne fait pas, l'imagination les fait.
[…]
Cependant la nuit tombait. Le soir qui a fourni à Virgile
tant de beaux vers, tous pareils par l'idée, tous différents
par la forme, versait l'ombre sur le paysage et le sommeil sur les
paupières des voyageurs. A mesure que les ténèbres
s'épaississaient et estompaient les informes silhouettes
de l'horizon, il me semblait - était-ce une illusion de la
nuit ? - que le pays devenait plus sauvage et plus rude, que les
piñadas et les clairières reparaissaient, et que nous
faisions en réalité, dans une obscurité profonde,
ce voyage des Landes que j'avais fait en imagination quelques heures
auparavant. Le ciel était étoilé ; la terre
n'offrait à l'œil qu'une espèce de plaine ténébreuse
où vacillaient çà et là je ne sais quelles
lueurs rougeâtres comme si des feux de pâtres étaient
allumés dans les bruyères ; on entendait sans rien
voir ni rien distinguer ce tintement fin et grêle des clochettes
qui ressemble à un fourmillement harmonieux, puis tout rentrait
dans le silence et dans la nuit, la voiture semblait rouler aveuglement
dans une solitude obscure, où seulement, de distance en distance,
de larges flaques de clarté apparaissant au milieu des arbres
noirs révélaient la présence des étangs.

|
![]()
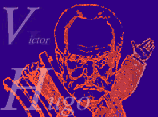

 les
étangs, solitudes d'eau, Sanguinet, Parentis, Mimizan, Léon,
Biscarosse, avec leur fauve population de loups, de putois, de sangliers
et d'écureuils, avec leur végétation inextricable,
surier, laurier franc, robinier, cyste à feuilles de sauge,
houx énormes, aubépines gigantesques, ajoncs de vingt
pieds de haut, avec leurs forêts vierges où l'on ne
peut s'aventurer sans une hache et une boussole ; on se représente
au milieu de ces bois immenses le grand Cassou, ce chêne mystérieux
dont le branchage hideux secoue sur toute la contrée les
superstitions et les terreurs. On pense qu'au delà des étangs
il y a les dunes, montagnes de sable qui marchent, qui chassent
les étangs devant elles, qui engloutissent les piñadas,
les villages, et les clochers, et dont les ouragans changent la
forme ; et l'on se dit qu'au delà des dunes il y a l'océan.
Les dunes dévorent les étangs ; l'océan dévore
les dunes. Ainsi, les landes, les étangs, les dunes, la mer,
voilà les quatre zones que la pensée traverse. On
se les figure l'une après l'autre, toutes plus farouches
les unes que les autres. On voit les vautours voler au dessus des
landes, les grues au dessus des lagunes, et les goëlands au
dessus de la mer. On regarde ramper sur les dunes les tortues et
les serpents. Le spectre d'une nature morne vous apparaît.
La rêverie emplit l'esprit. Des paysages inconnus et fantastiques
tremblent et miroitent devant vos yeux. Des hommes appuyés
sur un long bâton et montés sur des échasses
passent dans les brumes de l'horizon sur la crête des collines
comme de grandes araignées ; on croit voir se dresser dans
les ondulations des dunes les pyramides énigmatiques de Mimizan,
et l'on prête l'oreille comme si l'on entendait le chant sauvage
et doux des paysannes de Parentis, et l'on regarde au loin comme
si l'on voyait marcher pieds nus dans les vagues les belles filles
de Biscarosse coiffées d'immortelles de mer.
les
étangs, solitudes d'eau, Sanguinet, Parentis, Mimizan, Léon,
Biscarosse, avec leur fauve population de loups, de putois, de sangliers
et d'écureuils, avec leur végétation inextricable,
surier, laurier franc, robinier, cyste à feuilles de sauge,
houx énormes, aubépines gigantesques, ajoncs de vingt
pieds de haut, avec leurs forêts vierges où l'on ne
peut s'aventurer sans une hache et une boussole ; on se représente
au milieu de ces bois immenses le grand Cassou, ce chêne mystérieux
dont le branchage hideux secoue sur toute la contrée les
superstitions et les terreurs. On pense qu'au delà des étangs
il y a les dunes, montagnes de sable qui marchent, qui chassent
les étangs devant elles, qui engloutissent les piñadas,
les villages, et les clochers, et dont les ouragans changent la
forme ; et l'on se dit qu'au delà des dunes il y a l'océan.
Les dunes dévorent les étangs ; l'océan dévore
les dunes. Ainsi, les landes, les étangs, les dunes, la mer,
voilà les quatre zones que la pensée traverse. On
se les figure l'une après l'autre, toutes plus farouches
les unes que les autres. On voit les vautours voler au dessus des
landes, les grues au dessus des lagunes, et les goëlands au
dessus de la mer. On regarde ramper sur les dunes les tortues et
les serpents. Le spectre d'une nature morne vous apparaît.
La rêverie emplit l'esprit. Des paysages inconnus et fantastiques
tremblent et miroitent devant vos yeux. Des hommes appuyés
sur un long bâton et montés sur des échasses
passent dans les brumes de l'horizon sur la crête des collines
comme de grandes araignées ; on croit voir se dresser dans
les ondulations des dunes les pyramides énigmatiques de Mimizan,
et l'on prête l'oreille comme si l'on entendait le chant sauvage
et doux des paysannes de Parentis, et l'on regarde au loin comme
si l'on voyait marcher pieds nus dans les vagues les belles filles
de Biscarosse coiffées d'immortelles de mer.